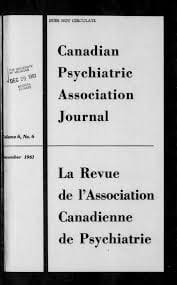Le Traitement dans le Service Pénal. Perspectives Nouvelles.
Actes du Xe Congrès Français de Criminologie. Lyon, 25-27 septembre 1969.
Masson & Cie, Editeurs- 224 pages.
Ce volume est un compte-rendu du XeCongres Francais de Criminologie. Il est composé de trois chapitres principaux ayant trait au traitement dans Ie secteur juvenile,Ie secteur carcéral adulte et Ie milieu ouvert et probatoire. Le traitement dans Ie service pénal en est à ses premiers balbutiements. Il y existe une absence notable de consensus. Les idées dans ce domaine sont polarisées par une serie d’antinomies: attitude répressive ou reeducative, traitement institutionnel vs traitement en milieu ouvert, classification poussée aboutissant a la creation de « ghettos typologiques » ou mixite penale visant à favoriser une meilleure « dialectique des rapports humains », optimisme therapeutique ou pessimisme thérapeutique, neutralité idéologique et non engagement social ou attitude de rupture et de contestation politique de l’institution carcérale et des mesures pénales traditionnelles, développement de services communautaires nouveaux selon Ie modele psychiatrique ou modernisation des structures pénales existantes, hegemonie exclusive du pouvoir legal ou integration multidisciplinaire et collegialite des decisions penales relatives au traitement. Voila autant de problèmes qui ont rebondi dans des termes moins violemment contradictoires lors de ce congrès.
Dans Ie secteur juvenile, malgre Ie developpement en France, a cote du systeme des maisons d’arrêt (centres de détention) de centres d’observations (C.O.) et de cen-tres de traitement (C.T.) pour delinquants,’des problemes majeurs subsistent:
- trop petit nombre de centres de traitement veritables pour les cas difficiles ou l’observation en milieu ouvert (O.M.O.) n’est pas possible,,
- distance géographique trop grande des institutions,
- super specialisation de certains centres selon Ie Q.I. et la technique d’apprentissage,
- transférements multiples d’organismes a organismes qui fragmentent la relation.
II existe en France un Service Social de Sauvegarde a l’Enfance qui est un service de consultation près les tribunaux pour mineurs, qui en plus du travail traditionnel d’enquête peut exercer une action educative en milieu ouvert (A.E.M.O.). Ces services sont insuffisants. Certains préconisent un travail communautaire qui serait une véritable « pédagogie de quartier » (travail dans la rue, a l’usine, école de parents, assistance éducative en milieu ouvert, centre d’observation dans Ie quartier). II s’agit d’un véritable traitement du milieu social attaquant la delinquance a ses sources.
En ce qui a trait à l’incarcération des mineurs un son de cloche assez diffèrent des pratiques actuelles fut émis par un auteur (Bressaud): recours a une courte incarcération (15 jours) dans des conditions de détention sévère et non permissive. Selon cet auteur les centres de redressement pour mineurs représentent une vie d’internat facile et déculpabilisante qui n’exerce aucun effet subséquent de dissuasion sur le comportement délinquant, De façon générale, dans Ie secteur carcéral adulte, il y a peu d’idées vraiment nouvelles. On préconise une ouverture des prisons dans une certaine continuité avec la communauté. « La prison doit s’ouvrir sur la cité et Ie monde du travail. » Cette approche est déjà en usage expérimental dans quelques pays d’Europe. Certains contestent d’emblée l’institution carcerale a partir d’options politiques. La prison et l’asile sont considèrés, dans cette perspective, comme des lieux privilégiés de « deresponsabilisation ». On souligne Ie caractere aliené et aliénant de toute institution, ses aspects anachroniques, ses obstacles (autocratie, règlementation en se plaçant au niveau du plus mauvais, manichéisme des fonctions, place accessoire de la rééducation, peur des réactions agressives). D’autres soutiennent qu’on doit moderniser les prisons, leur inclure un « centre medico-psychologique » pour fins d’observation et de traitement, assurer un dépistage rapide des problèmes physiques et psychologiques, améliorer la formation du personnel et Ie système de classification des detenus et effectuer une meilleure coordination des services. La contestation la plus radicale est venue de Madame Buffard.Selon elle, les longues incarcérations sont « un temps mort » et « aucun traitement ne lui insufflera la vie ».
L’ établissement d’une véritable communauté pénitentiaire est vue comme une tâche difficile sinon impossible à cause de la nature même e de la prison (création et dissolution permanente du milieu, loi d’homologie et d’homeostasie -Hochmann).Certains concluent que l’institution peut etre traitée, que des approches thérapeutiques peuvent y etre effectuées (psychotherapie de groupe en France depuis 1962 dans certaines institutions penales), D’autres préconisent une contestation globale du systeme politique dans lequel s’insere la prison. Les perspectives d’avenir les plus avancees sont degagées par Roumajon: organisation du traitement penal a partir du developpernent d’un scheme de soins communautaires gradues, l’utilisation eventuelle de la prison comme service d’urgence uniquement.Dans Ie domaine du traitement ouvert et de la probation les perspectives reeducatives sont tres larges allant du simple sursis aune « tutelle penale » extremement poussee,
L’action reeducative doit deborder le cadre de l’approche medico-socio-educative individuelle pour toucher des dimensions preventives generales visant a traiter Ie milieu social lui-meme.Au plan des politiques penales l’interet de la criminologie en regard de I’elaboration de normes legislatives dans une societe en pleine evolution a ete soulignee.De facon generale, les actes de ce congres presentent un interet scientifique limite:discours de circonstances, description des structures juridico-penales francaises, principes generaux, exposes descriptifs du fonctionnement de certaines institutions penales et psychiatriques. On peut deplorer l’absence d’evaluation objective des programmes de traitement dans Ie service penal. II est trop tôt pour l’exiger. Par ailleurs, certaines presentations (Hochmann, Gayraud, Buffard) posent aux institutions comme dispositifs de traitement des interrogations extremement serieuses sur lesquelles les specialistes du traitement institutionnel auraient avantage a se pencher.
Claude Morand, m.d.Montreal.