Gabriel TARDE: des contributions majeurs à la criminologie
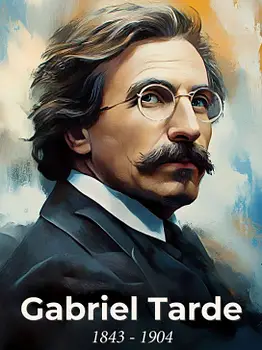 Gabriel Tarde (1843–1904) est un magistrat, sociologue et philosophe français, reconnu comme l’un des pionniers de la criminologie moderne. Son approche novatrice a profondément influencé la compréhension des comportements criminels et des dynamiques sociales.
Gabriel Tarde (1843–1904) est un magistrat, sociologue et philosophe français, reconnu comme l’un des pionniers de la criminologie moderne. Son approche novatrice a profondément influencé la compréhension des comportements criminels et des dynamiques sociales.
à Sarlat, en Dordogne. Il est le fils d’un juge d’instruction et se destinera à son tour à cette carrière. Du fait d’une maladie qui le retient alité durant toute sa jeunesse, il devient de surcroît un bon connaisseur de la philosophie et des sciences humaines de son temps. Ainsi, tout en poursuivant sa carrière de magistrat de province, il entame au début des années 1880 une vie d’intellectuel. Il se fera connaître d’abord par ses articles de psychologie publiés dans la Revue philosophique de Théodule Ribot. Il se distingue ensuite rapidement par ses textes de criminologie qui comptent parmi les premières réactions contre le “ fatalisme biologique ” de Lombroso. En 1886, il rassemble ces écrits dans La criminalité comparée, ouvrage qui connaît un franc succès et qui amène notamment Alexandre Laccassagne à solliciter sa collaboration pour les Archives d’anthropologie criminelle qu’il vient de fonder à Lyon.
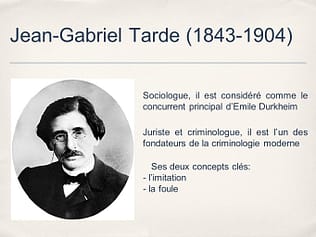 Enfin, avec la publication des Lois de l’imitation en 1890, Tarde se positionne comme un théoricien majeur des sciences humaines en général. Il profite en effet de l’engouement général que suscitent à cette époque les recherches sur l’hypnose et la suggestion. La reconnaissance institutionnelle arrive rapidement. Il est nommé à la direction de la statistique judiciaire au ministère de la justice en 1894, puis surtout élu au Collège de France en 1900. Tarde est alors à l’apogée de sa vie et de sa carrière d’intellectuel. Pourtant, sa théorie de l’imitation est déjà critiquée. A vouloir tout expliquer, elle apparaît comme trop générale par rapport aux travaux de recherches empiriques rigoureux que promeut l’équipe emmenée par Emile Durkheim autour de l’Année sociologique. De fait, au moment de sa mort, en 1904, Tarde a déjà laissé échapper le leadership de la sociologie française à son jeune rival. Il n’en demeure pas moins une figure marquante de la fin du XIXème siècle et l’un des premiers et des plus importants opposants à la criminologie biologique de Lombroso.
Enfin, avec la publication des Lois de l’imitation en 1890, Tarde se positionne comme un théoricien majeur des sciences humaines en général. Il profite en effet de l’engouement général que suscitent à cette époque les recherches sur l’hypnose et la suggestion. La reconnaissance institutionnelle arrive rapidement. Il est nommé à la direction de la statistique judiciaire au ministère de la justice en 1894, puis surtout élu au Collège de France en 1900. Tarde est alors à l’apogée de sa vie et de sa carrière d’intellectuel. Pourtant, sa théorie de l’imitation est déjà critiquée. A vouloir tout expliquer, elle apparaît comme trop générale par rapport aux travaux de recherches empiriques rigoureux que promeut l’équipe emmenée par Emile Durkheim autour de l’Année sociologique. De fait, au moment de sa mort, en 1904, Tarde a déjà laissé échapper le leadership de la sociologie française à son jeune rival. Il n’en demeure pas moins une figure marquante de la fin du XIXème siècle et l’un des premiers et des plus importants opposants à la criminologie biologique de Lombroso.
Contributions majeures à la criminologie
1. Critique du déterminisme biologique
Tarde s’oppose fermement à la théorie du « criminel-né » de Cesare Lombroso, qui attribue la criminalité à des facteurs biologiques héréditaires. Dans La Criminalité comparée (1886), il soutient que le crime est un phénomène social, influencé par l’environnement et les interactions humaines, plutôt que par des prédispositions biologiques.
2. Théorie de l’imitation

-
Loi de la descente : les innovations se diffusent des couches sociales supérieures vers les inférieures.Nouvelle Encyclopédie Mondiale
-
Loi de proximité : les individus imitent davantage ceux qui leur sont proches géographiquement ou socialement.
-
Loi de l’adaptation : les imitations se modifient en fonction des contextes culturels et sociaux.
Cette théorie met en lumière le rôle des interactions sociales dans la formation des comportements déviants.
3. Analyse des comportements collectifs

Influence et postérité
Bien que son œuvre ait été éclipsée par celle d’Émile Durkheim, Tarde a exercé une influence notable sur la sociologie, la psychologie sociale et la criminologie. Ses idées ont été redécouvertes au XXe siècle et continuent d’inspirer les recherches sur la diffusion des comportements sociaux et les mécanismes d’influence.


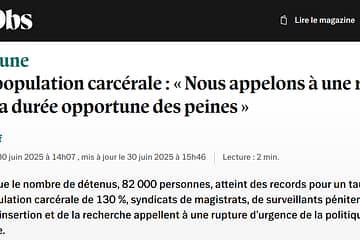
0 commentaire