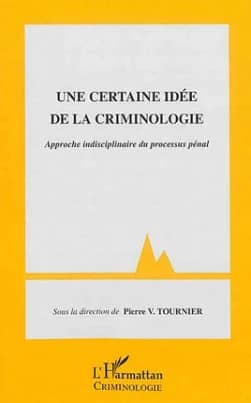 Pierre-Victor Tournier et son ancrage disciplinaire
Pierre-Victor Tournier et son ancrage disciplinaire
Pierre-Victor Tournier est directeur de recherches au CNRS, spécialiste de démographie pénale et chercheur au Centre d’histoire sociale du XXᵉ siècle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Formé aux mathématiques appliquées et à la démographie, il est également fondateur de la revue Champ pénal / Penal field et de la collection Arpenter le champ pénal (ACP). Ancien président de l’Association française de criminologie, il a publié de nombreux travaux sur la population carcérale et les politiques pénales (parmi lesquels Dialectique carcérale [dir., 2012], Enfermements [dir., 2012] ou La prison : une nécessité pour la République [2013]). Son approche pluridisciplinaire, mêlant démographie statistique et sciences sociales, ancre son profil à la fois dans les études de population et en criminologie.
Contexte de publication
Une certaine idée de la criminologie est paru en octobre 2013 chez L’Harmattan (collection “Criminologie”). Il s’agit d’un ouvrage collectif dirigé par Tournier, rassemblant 18 contributeurs issus de divers horizons (juristes, sociologues, magistrats, psychiatres, philosophes, etc.). Il s’inscrit dans le prolongement de débats contemporains sur la pertinence des politiques pénales en France, dans un climat marqué par la conférence de consensus sur la prévention de la récidive (2012-2013) lancée par la ministre de la Justice Christiane Taubira. Tournier justifie la parution de cet ouvrage par le désir de « conjurer la malédiction qui semble frapper la criminologie en France » et d’échapper au « modèle mortifère de la ‘Babel criminologique’ ». Cette formule fait écho à des constats antérieurs (par ex. Mucchielli 2004) selon lesquels la criminologie française n’a jamais été une discipline autonome, existant plutôt « au carrefour » du droit, de la médecine et des sciences sociales. L’ouvrage se veut donc une réponse collective à cette situation : regrouper des points de vue divergents pour défendre, « ensemble et pacifiquement, une certaine idée de la criminologie » en ayant chacune et chacun la sienne. Paradoxe ? Pas sûr. Comme l’affirmait, courageusement, Christiane Taubira, Garde des Sceaux, le 14 février 2013, en ouvrant les auditions publiques de la conférence de consensus sur la prévention de la récidive, « il faut savoir se mettre en péril en acceptant la complexité des choses ».
Contributeurs : Claudine Bansept, Alain Blanc, Lucie Bony, Robert Cario, Alain Cugno, Steve Ducommun-Vaucher, Daniel Fink, Anne d’Hauteville, Martine Herzog-Evans, Eric Kania, Pierre Lamothe, Jean-Manuel Larralde, Philippe Pottier, Laurent Ridel, Cyril Rizk, Bernard Savin, Christophe Soullez et Pierre V. Tournier.
Thèses principales de l’ouvrage
L’ouvrage, intitulé Approche interdisciplinaire du processus pénal, est structuré en quatre parties (plus introduction et conclusion) : une introduction générale, puis les volets I) « Introduction à l’approche criminologique », II) « Réponses pénales : des sanctions sur mesure ? », III) « Surveiller et soigner », IV) « Prévenir ». Chaque partie regroupe plusieurs contributions. On en retiendra les points-clés suivants :
- Introduction générale (Tournier) – Tournier place d’emblée la criminologie comme une étude scientifique du phénomène criminel et des réponses sociales qui y sont apportées. Il insiste sur son caractère interdisciplinaire : la criminologie mobilise le droit, la criminalistique, les sciences sociales (sociologie, histoire, science politique, démographie pénale…), les sciences médicales et psychiques (médecine légale, psychiatrie, psychanalyse…) et la philosophie. L’enseignant chercheur, selon lui, doit associer universitaires et praticiens (professionnels de la justice, de la police, du soin social, etc.) pour appréhender le phénomène criminel dans sa complexité. On y retrouve la conviction que la discipline doit rester rigoureuse et factuelle, en évitant la « propagande partisane ».
- I. Introduction à l’approche criminologique – Cette partie regroupe cinq chapitres d’introduction :
- Mesurer le crime (Christophe Soullez) souligne la complexité des statistiques officielles. Il montre l’intérêt des enquêtes de victimation pour quantifier la criminalité non enregistrée et alerter sur les biais des seules statistiques policières.
- Enquêtes de victimation (Cyril Rizk) explore les apports de ces enquêtes nationales (internationales) pour comprendre la victimisation et la perception de l’insécurité.
- Prévention, identification, enquête (Soullez) traite du rôle des forces de l’ordre : la mise en place de stratégies préventives, d’identification des délinquants et de nouvelles techniques d’investigation, soulignant le lien entre politique de sécurité et données statistiques.
- Analyse démographique du champ pénal (P. V. Tournier) fournit un panorama chiffré de la population pénale : profils sociologiques des détenus, durées de peine, mouvements carcéraux. Cette « démographie pénale » permet de replacer les débats (par exemple sur la surpopulation carcérale) dans une perspective scientifique.
- Formation en criminologie (L. Ridel et Ph. Pottier) insiste sur la nécessité d’une formation spécifique pour les professionnels du droit, de la sécurité et du social. En réunissant des juristes, policiers et travailleurs sociaux, on harmonise les savoirs et on évite la fragmentation disciplinaire.
- II. Réponses pénales : des sanctions sur mesure ? – Cette section étudie l’applicabilité et le sens de la peine dans divers contextes :
- Influence du Conseil de l’Europe (J.-M. Larralde) rappelle les normes européennes (Charte des droits fondamentaux, CoE) en matière de sanction et incite au respect de principes tels que la proportionnalité et l’individualisation de la peine.
- Sens du crime et processus judiciaire (A. Blanc) traite des représentations pénales : comment les juges et jurés construisent le « sens » d’un délit ou d’un crime à partir des faits et des contextes sociétaux, et comment cela influe sur la peine infligée.
- Abolition et altération du discernement (P. Lamothe) présente le regard psychiatrique sur les délinquants jugés non responsables (infirmes mentaux). Il montre la complexité du traitement psychiatrique en milieu pénal et les débats éthiques (entre soin et enfermement).
- Place des victimes (A. d’Hauteville) s’interroge sur l’évolution du rôle de la victime dans le procès pénal : droits de la victime, participation aux débats d’assises, réparation… Elle souligne les tensions entre logique rétributive et prise en compte du préjudice subi.
- « Plafond des six mois » (M. Herzog-Evans) analyse l’effet d’une disposition pratique : le verrou légal de six mois pour les mesures de sûreté sous écrou. Elle recueille le témoignage de praticiens qui jugent cette règle parfois arbitraire et appelle à une réflexion sur l’équilibre entre liberté et prévention de la récidive.
- Politiques suisses de l’emprisonnement (D. Fink et St. Ducommun-Vaucher) comparent les politiques de peine privative de liberté en Suisse et en France. En Suisse, la philosophie est axée sur le traitement social des délinquants et la proximité du milieu libre – un contraste éclairant avec le modèle français plus centré sur la répression.
- Justice restaurative (R. Cario) décrit le principe de justice réparatrice (conciliation, médiation) comme un « utopisme rationnel » porté par certains pays anglo-saxons. Il revient sur les expérimentations françaises et conclut que, bien qu’elle ne remplace pas le tribunal, la justice restaurative peut compléter l’arsenal pénal pour certains crimes en recentrant le débat sur la réparation et la réinsertion.
- III. Surveiller et soigner – Cette partie explore l’articulation entre contrôle pénal et prise en charge thérapeutique :
- Soin et obligation de soin (É. Kania) distingue différentes modalités d’intervention sanitaire en milieu pénal (soin volontaire, injonction de soins, obligation légale). Il examine les débats sur l’efficacité des traitements psychiatriques en prison et la délimitation entre punition et thérapie.
- Psychothérapie et violence sexuelle (B. Savin) milite pour les thérapies de groupe auprès d’auteurs de violences sexuelles. Il présente des résultats positifs de prises en charge collectives, et critique l’isolement des délinquants sexuels qui favorise la récidive.
- UHSA (Unités Hospitalières Spécialement Aménagées) (P. Lamothe) décrit ce nouvel outil français (créé en 2011) : ce sont des unités hospitalières accueillant des détenus psychiatrisés. L’auteur montre comment elles réintroduisent une dimension sanitaire dans l’enfermement, répondant partiellement à la double mission de soin et de sûreté.
- IV. Prévenir – La dernière partie traite des stratégies de prévention et d’insertion :
- Réduction des violences et traitement de la délinquance (C. Bansept) adopte un point de vue sociologique sur les politiques publiques de prévention : elle interroge l’efficacité des programmes de prévention situés (politique de la ville, éducation) et plaide pour des actions globales intégrant éducation, santé et cohésion sociale.
- Récidive et réinsertion (P. V. Tournier) poursuit le thème des chapitres précédents sur la récidive. Il propose une analyse des trajectoires d’infraction, de (ré)insertion et de désistance. En confrontant données statistiques et récits individuels, il nuance le concept de récidive et interroge les conditions d’une sortie de la délinquance.
- Groupes de paroles et récidive (Ph. Pottier) présente un dispositif de « groupes de paroles » (sessions collectives d’échanges) pour détenus en probation. Ces groupes visent à prévenir la récidive en travaillant sur la responsabilisation et le lien social. Pottier livre un bilan positif de ces expérimentations, tout en notant leurs limites en milieu carcéral fermé.
- Sortie de prison et parcours résidentiels (L. Bony) étudie les trajectoires post-carcerales via des entretiens avec d’anciens détenus. Elle met en évidence les obstacles matériels et psychologiques à la réinsertion (logement, emploi, stigmatisation) et plaide pour des politiques mieux coordonnées entre justice, travail social et logement.
Enjeux scientifiques et épistémologiques
Ce livre illustre plusieurs enjeux épistémologiques clés pour la criminologie contemporaine. D’abord, il réaffirme la nature scientifique de la discipline : Tournier insiste sur la nécessité de fonder les politiques pénales sur des connaissances évaluées et des données empiriques fiables. À cet égard, l’ouvrage est fidèle à la logique de la « conférence consensus » de 2012-2013, que la Garde des Sceaux décrivait comme une démarche pragmatique et rigoureuse, « inspirée par le pragmatisme, marquée par la rigueur » et reposant sur des « données évaluées ». En effet, plusieurs chapitres mettent l’accent sur l’apport de l’analyse statistique (par exemple la démographie pénale) pour éclairer les débats (surpopulation carcérale, récidive…) et combattre les idées reçues.
Ensuite, l’ouvrage met en pratique une épistémologie du pluralisme disciplinaire. La criminologie est présentée non comme une théorie unique, mais comme un carrefour de savoirs où coexistent approches juridique, clinique, sociale, statistique et philosophique. Chaque contributeur apporte sa propre « idée » de la criminologie, depuis l’économiste (démographe pénal) jusqu’au philosophe ou au praticien de justice. Plutôt que de viser l’unification doctrinale, les auteurs revendiquent le droit à la divergence constructive : comme l’écrit Tournier, « on peut défendre, ensemble et pacifiquement, une certaine idée de la criminologie en ayant chacune et chacun la sienne ». Cette posture critique s’oppose à une vision dogmatique : elle souligne que la complexité du phénomène criminel exige de « consentir à la complexité » et d’« affronter » des points de vue contradictoires (image empruntée à Taubira reprise dans le livre).
Par ailleurs, l’ouvrage prend résolument ses distances vis-à-vis de certaines orientations pénales classiques. Plusieurs contributions pointent les limites d’une politique « tout carcéral » et proposent des alternatives (probation, soins psychiatriques, justice restaurative) afin de rendre les sanctions plus « sur mesure ». Par exemple, l’étude sur les Unités hospitalières et sur les obligations de soins interroge l’usage de la prison pour malades mentaux, tandis que le chapitre sur la justice restaurative questionne la sacralisation du procès accusateur classique. Dans chaque cas, les auteurs combinent analyse critique des pratiques actuelles et ouverture vers des modèles innovants (conventions internationales, exemples suisses, programmes de prévention), suivant l’idée que « l’enfermement mal conçu, mal conduit produit de la récidive ».
Enfin, les enjeux scientifiques passent aussi par la mise en dialogue académique-pratique. En réunissant chercheurs et praticiens, l’ouvrage cherche à combler la « Babel criminologique » évoquée par Tournier. L’épistémologie qui sous-tend ce projet consiste à ne pas séparer l’étude du crime (recherches, statistiques, thèses) de la réflexion sur la peine (avocats, juges, conseillers pénitentiaires). Cette interaction joue à plusieurs niveaux : par exemple, la sociologue Bansept relie la recherche en violence urbaine aux politiques de prévention en milieu urbain, et le magistrat A. Blanc éclaire les décisions judiciaires par une lecture de théorie du droit. Ce maillage disciplinaire contribue à une meilleure intelligibilité du champ pénal pour la société (une préoccupation affirmée dans le discours de Taubira) et, simultanément, crée une épistémologie de la criminologie ancrée dans le concret des politiques publiques.
Appréciation critique et apport
Une certaine idée de la criminologie constitue un apport important pour la criminologie française contemporaine, à plusieurs titres. D’une part, c’est un ouvrage pédagogique et complet : il offre un panorama vaste des questions clés du champ pénal (statistiques, victimes, justice pénale, soins, prévention) et illustre la diversité des méthodes scientifiques (quantitatives et qualitatives). Il peut servir de manuel ou de support de cours pour étudiants en droit et sciences sociales, car il explicite jargon et concepts (victimation, altération du discernement, probation, UHSA, désistance, etc.).
D’autre part, son apport épistémologique est tangible. En montrant concrètement comment 18 auteurs de profils différents peuvent coopérer, l’ouvrage incarne une voie médiane entre la confusion doctrinale et l’uniformité idéologique. Il ne prétend pas imposer un modèle unique de criminologie, mais prouve qu’un « bricolage » critique est possible : on peut regrouper des données statistiques solidement établies et des réflexions juridiques ou cliniques sans trahir l’intégrité de chaque discipline. Ce faisant, il alimente le débat sur les politiques pénales en mettant à disposition de la réflexion publique des analyses rigoureuses et nuancées.
Sur le plan critique, l’ouvrage ne fait pas complètement consensus : certains lecteurs pourraient lui reprocher de rester descriptif, sans posser un projet de réforme pénale unique. Mais c’est précisément là son parti pris : au lieu de préconiser une politique pénale « idéale », il offre plusieurs pistes compatibles (par exemple, individualisation de la peine, alternatives à l’incarcération, renforcement du lien social) et insiste sur la nécessité du dialogue continu entre chercheurs et décideurs. Ainsi, même si l’ouvrage n’est pas un traité théorique unifié, il constitue une contribution utile aux débats actuels en fournissant des cadres d’analyse variés et une critique partagée du « tout-répressif ».
En somme, Une certaine idée de la criminologie montre qu’il existe aujourd’hui en France un vivier intellectuel capable de dépasser les clivages traditionnels. Il reprend et développe des questions soulevées dans les ouvrages antérieurs de Tournier (p. ex. Dialectique carcérale, Babel criminologique) et les enrichit de nouveaux éclairages (soin psychiatrique, groupes de parole, justice restaurative). Son approche collective et interdisciplinaire est susceptible de nourrir la réflexion des chercheurs comme des praticiens : en alignant rigueur scientifique et pluralité des regards, il facilite l’émergence de politiques pénales mieux informées par la recherche.
Bibliographie succincte
En complément de Une certaine idée de la criminologie (dir. P.-V. Tournier, L’Harmattan, 2013), on pourra se référer à d’autres travaux de l’auteur et de ses collaborateurs sur des thèmes voisins : par exemple, Dialectique carcérale (dir. Tournier, L’Harmattan, 2012) ou Enfermements (dir. Tournier, L’Harmattan, 2012) pour des analyses de l’institution carcérale ; La prison : une nécessité pour la République (Buchet-Chastel, 2013, préface d’E. Guigou) pour la question de l’emprisonnement ; ainsi que les écrits de plusieurs contributeurs de l’ouvrage (par ex. Robert Cario, Martine Herzog-Evans, Alain Blanc) déjà cités. Ces références montrent la cohérence et la continuité du projet intellectuel de Tournier autour d’une criminologie empirique et engagée dans l’étude critique des politiques pénales.


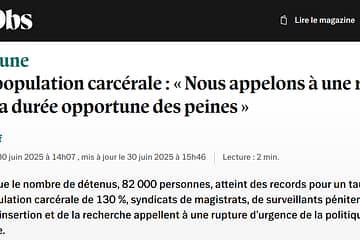
0 commentaire