 Extrait: Arnaud Philippe / Vous étiez chef de bureau puis sous-directeur de la réinsertion à la direction de l’administration pénitentiaire de 1985 à 1995. Pouvez-vous nous expliquer comment l’idée des Unités de vie familiale (UVF) est née et s’est concrétisée ?
Extrait: Arnaud Philippe / Vous étiez chef de bureau puis sous-directeur de la réinsertion à la direction de l’administration pénitentiaire de 1985 à 1995. Pouvez-vous nous expliquer comment l’idée des Unités de vie familiale (UVF) est née et s’est concrétisée ?
Alain Blanc / À partir des travaux de la Commission architecture mise en place par Robert Badinter. Je venais d’arriver à la direction de l’administration pénitentiaire comme chef
du bureau de la réinsertion et je me souviens d’avoir été frappé par l’intervention de Robert Badinter lors de la réunion de remise du rapport de la commission qu’il avait commandé : selon lui, ce qu’il fallait surtout retenir de ces travaux, c’était l’idée qu’il ne fallait pas construire de prisons pour plus de 50 ans. La société change tellement qu’il ne faut pas figer les choses dans le béton de manière définitive. Il fallait tendre vers le concept de prisons modulables et accepter l’idée qu’au bout d’un certain temps, elles deviennent caduques, et ne sont plus adaptées au monde et aux politiques qui évoluent, et qu’il faut donc en changer.
Par ailleurs, à mon niveau et compte-tenu de ce qu’étaient mes propres responsabilités, je retiens deux grands chantiers qui ont été ouverts grâce aux travaux de cette commission.
Le premier, précisément à partir de cette idée de ne pas se laisser bloquer par les murs, avait été de tenter l’expérience d’une détention adaptée aux opérations « prévention-été »mises en place depuis 1983 par Gilbert Bonnemaison. L’idée était de regrouper des jeunes détenus en courte peine pour préparer leur sortie dans une détention « allégée » et consacrée à des activités de formation ou de sport.
Exactement comme les jeunes ciblés par les opérations été dans les cités, et en fondant ce travail sur la prévention de la récidive. Le GENEPI y avait été associé. L’autre chantier, c’est celui qu’on appelait alors le dossier des « parloirs intimes ou sexuels», devenus « Unités de vie familiale », UVF.
AP / Quel service s’est occupé de ce dossier ?
AB / Ce qu’il faut d’abord dire, c’est que c’était un dossier particulièrement délicat. Un dossier à symbolique très forte. Le titre du livre de Jacques Lesage de La Haye, La guillotine du sexe, le souligne suffisamment en 1978. Puis un autre livre d’un autre ancien détenu, Alain Monnereau, La castration pénitentiaire. Fondamentalement, la peine, c’est bien sous les deux sens de ce mot qu’il faut l’entendre, et les deux renvoient bien à l’idée de souffrance qui est contradictoire avec celle de plaisir.
D’une certaine manière, en elle-même la privation de la liberté d’aller et venir se traduit par une autre « violence légitime », celle de la privation d’une vie sexuelle « normale », avec tous les troubles et conséquences que cette privation génère nécessairement. Il faut le savoir. Et les réponses à apporter sont d’autant plus délicates que la question touche
à l’intimité de chacun, dans un univers où la pudeur est déjà mise à mal, c’est le moins qu’on puisse dire.
Pour répondre à votre question, c’était un dossier piloté par mes services parce que j’étais responsable de la réinsertion. Il s’agissait d’emblée d’un sujet centré sur la question de
la réinsertion, de la protection des liens qui permettent de faciliter un retour du condamné à la vie libre sans récidive. Et le fondement des politiques mises en place à l’époque dans ce domaine, c’était toujours ce principe du « décloisonnement » : tous les droits qui ne sont pas supprimés ou réduits par la décision de justice privative de liberté et la réalité induite par cette privation de liberté doivent pouvoir être exercés, ou en tous cas l’accès à leur exercice doit être aménagé par l’administration. Et le droit à une vie affective et sexuelle en est un.
Même si c’est évidemment beaucoup plus complexe à analyser et à mettre en œuvre que le droit à la formation où à la culture par exemple.
Nous avions la conscience claire que l’interdiction de principe, posée d’ailleurs de manière très subliminale dans la réglementation, était contournée de telle manière que des situations de fait existaient qui étaient indignes pour tout le monde : pour les femmes qu’on laissait quelques instants avec leur mari ou compagnon détenu, derrière un drap accroché dans un coin du parloir, et pour le détenu. Et aussi pour les surveillants objectivement « complices » de cette situation d’infra-droit. Entendons-nous bien : je ne suis pas en train de dire que ces situations ont cessé. Sans doute pas. Mais dans ce domaine comme dans d’autres, surtout dans une institution « de contrainte » comme la prison, les évolutions ne se font ni d’un claquement de doigt, ni avec une circulaire, ni même avec une loi. Et encore moins dans un domaine aussi complexe que celui de la sexualité.
Pour revenir à l’histoire des UVF, précisément, la première pierre en a été posée tout de suite par Mme Myriam Ezratty qui en 1983, dès son arrivée à la direction de l’administration pénitentiaire, a fait en sorte que Jacques Lesage de la Haye, l’auteur de La guillotine du sexe et ancien membre du Groupe Information Prisons (GIP) créé par Michel Foucault puis du Comité d’Action des Prisonniers, fasse partie de la Commission architecture. Avec à la clé, dans le cahier des charges de la commission, la question de savoir « comment aménager les prisons pour permettre la sexualité ? ». C’est là que ça commence. Poser la question d’emblée sur le « comment ? », c’était déjà une manière de lever le « tabou » et d’avancer. La Commission architecture a donc rendu son rapport en 1985, avec des préconisations concrètes sur le sujet et un premier établissement a été conçu puis construit sur cette base.
Il s’agit du Centre de détention de Mauzac avec des « studettes », dont la finalité n’était pas très éloignée de ce que seront les UVF un peu plus de vingt ans plus tard. La suite mériterait une analyse fine et serait un bon sujet de mémoire pour un étudiant de sciences-politiques ! Je vais juste vous donner quelques étapes dont j’ai le souvenir. Après les élections législatives de 1986 et avec la première cohabitation, Albin Chalandon a été nommé garde des Sceaux. Sa priorité était ce qu’il appelait alors le « programme 15 000
places » de prison qu’il conçoit au départ comme des prisons construites et gérées par des entreprises privées. Ce qui a constitué tout de même pour les personnels du service public pénitentiaire, y compris pour les syndicats majoritaires plutôt conservateurs, un sacré choc ! À côté de cela, il ne m’a pas semblé que la question des « studettes » ait été un sujet sur lequel le ministre se serait battu. Ni pour, ni contre d’ailleurs. Mais il avait nommé un nouveau directeur, Arsène Lux, préfet, qui a été très ferme : « il n’y aura pas de relations sexuelles dans les prisons tant que je serai directeur ». Et comme les personnels y étaient très majoritairement opposés et que la « privatisation » d’une partie du service public pénitentiaire passait mal, le dossier a été tout simplement rayé de la carte et on a détruit matériellement ou réaffecté les studettes existantes ou commencées. Et à l’administration centrale, nous avons rangé le dossier dans un classeur vertical en attendant un contexte plus favorable. Nous étions un peu découragés, même si on savait bien que c’était une réforme nécessaire mais impopulaire dans l’opinion comme au sein de l’administration. Ou en tous cas pour laquelle personne n’était prêt à défiler ou à faire des tracts ! Mais à chaque nouveau directeur nous avons essayé de ressortir le dossier. En vain. Dans ce domaine, les choses et les mentalités avaient évolué : je pense en particulier au travail remarquable fait par Marie-France Blanco et l’association Relais Enfants-Parents dans ses années-là et depuis : il est devenu possible d’aménager en détention des contacts avec parloirs aménagés pour les enfants des détenu(e)s, ce qui paraissait impensable quelques années plus tôt. Nous avons donc choisi de minorer la dimension sexuelle et « droit à » pour privilégier celle de la prévention de la récidive via le maintien des liens familiaux. Et en posant le principe de restreindre, dans un premier temps, le dispositif aux condamnés moyennes et longues peines ne disposant pas de permissions de sortie. Et on appelé ça les Unités de vie familiale. Nous avons aussi mis en avant les expériences qui étaient faites en Europe et dans des pays où, malgré l’état souvent déplorable des prisons, des parloirs de ce type étaient aménagés. Mais en gardant le souci de définir un système qui garantisse la dignité des personnes et en particulier des partenaires libres venant en détention à cette fin. De ce point de vue, le dispositif qui existait dans ces années-là en Catalogne ne nous paraissait pas satisfaisant : l’aménagement de locaux ad hoc avec distributeurs de préservatifs pour un contact de deux à trois heures nous est toujours apparu comme devant être évité, car réduit à la simple dimension sexuelle. Dans notre esprit, il fallait concevoir le système pour au moins une journée et une nuit.
En 1989, Gilbert Bonnemaison qui avait été chargé de faire un rapport sur la modernisation du service public pénitentiaire après une série d’émeutes extrêmement graves dans les
prisons, qu’on semble avoir déjà oubliées, avait fait valoir de nouveau le bien fondé de ce dossier. Mais rien n’a été possible avant la cohabi- tation Chirac/ Jospin et l’engagement d’Élisabeth Guigou sur ce dossier à partir de 1997.
J’ai suivi de loin comment les choses se sont alors passées. Je sais qu’il y a eu un engagement fort du cabinet, du directeur de l’époque et de la sous-directrice qui m’avait succédé, Isabelle Gorce. Avec un plan par étapes, en commençant par un établissement pour femmes, la maison centrale de Rennes.
Entre temps, en interne, l’administration avait déjà évolué. Les turbulences des émeutes passées avaient rendu plus urgentes les réformes. Les mentalités et les personnels ont évolué : recrutés à un meilleur niveau, mieux formés. Il faudrait analyser les évolutions qui se sont produites, et qui sont complexes à repérer : dans les années 90, l’éclate
ment du « monopole » syndical chez les personnels de direction tenu pendant des décennies par Force Ouvrière et son patron charismatique, Hubert Bonaldi, avec la création du syndicat CGC par Jean-Marc Chauvet et une autre génération. Dans le même temps, les syndicats de personnels de surveillance se sont « émancipés » du lien étroit avec le syndicat majoritaire des directeurs, et le paysage syndical a « éclaté » avec la montée en puissance de la CGT et de l’UFAP. C’en était fini du bloc qui autogérait l’institution et du coup, les positions des syndicats étaient plus diversifiées. Dans un tout autre domaine, venant du dehors, il y a aussi eu les politiques de prévention du sida appuyées à l’AP sur la réforme fondamentale de la santé en prison qui a abouti à la loi du 18 janvier 1994.
À ce sujet, je me souviens très bien d’avoir été chargé à l’époque par le directeur, Jean-Claude Karsenty, d’expliquer aux syndicats l’exigence de Matignon, dans le cadre de la politique de prévention du VIH, que soient distribués des préservatifs en détention : je devais leur expliquer qu’on distribuait partout des préservatifs,
que le débat avait lieu dans toutes les institutions, et que vu le nombre de toxicomanes détenus , il fallait à la fois protéger les détenus et la population libre qu’ils retrouveraient nécessairement. Et là je garderai toujours en mémoire la réponse d’Alexis Grandhaie, responsable de la CGT des personnels de surveillance à l’époque, qui en substance était la suivante : « On a compris : ce que vous nous dites, c’est qu’il faut qu’on continue à prévenir et à interdire les rapports sexuels entre détenus, et qu’on accepte en même temps qu’ils aient accès à des préservatifs afin de se protéger s’ils en ont malgré tout ? Pas de problème : entre la protection de la loi et celle de la vie, le choix est clair. Vous pouvez compter sur nous. »
Il faut peut-être faire un effort pour réaliser aujourd’hui à quel point cette réponse traduisait à l’époque un remarquable sens des responsabilités, et une véritable intelligence de la
complexité de la situation. Parce qu’ensuite, il fallait tout de même l’expliquer aux agents en détention ! Vous comprendrez que depuis cette période, et à partir de cette expérience, les discours des bonnes âmes sur les réformes à faire au nom des « y’a qu’à faut qu’on » et qui ne tiennent aucun compte de la capacité des personnels à faire progresser l’institution me paraissent assez faciles!
Avec cette politique de prévention du VIH et les débats qu’elle a nécessairement générés sur la sexualité en détention, les mentalités ont aussi évolué, au sein de l’administration et dans l’opinion, sur les futurs UVF. Je pense aussi que, d’une certaine manière, on a gagné sur notre choix d’en faire un peu le fer de lance d’une politique de maintien des liens
familiaux. Pourquoi ? Parce que pour penser et mettre en œuvre une telle réforme, il faut évidemment ne pas se placer que « du côté des détenus ». Il faut aussi penser à leurs parte naires qui, soit dit en passant, sont le plus souvent les premières victimes de l’incarcération de leur compagnon ou mari. Sur le plan économique, affectif et sexuel, sans parler de la charge des enfants et de la stigmatisation sociale induite par l’incarcération de ce dernier.
La question de l’aménagement d’un droit à la sexualité des détenus ne peut être isolée de celle des droits et exigences du conjoint et de l’obligation pour l’administration de prendre
en compte sa dignité qui n’est pas toujours le souci premier du conjoint ou compagnon.
Reste un point que je n’ai toujours pas pu expliquer dans l’historique de ce sujet et qu’il serait intéressant de creuser : le cas particulier du Centre de détention de Casabianda qui, outre son accès libre à la mer a, à ma connaissance, pratiquement toujours eu un « parloir sexuel » avec à l’entrée, une pièce avec un vague lit pour les visites des conjointes.

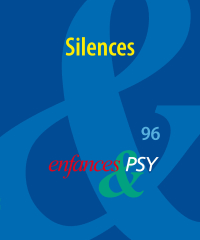

0 commentaire