À PROPOS DU RAPPORT DE DOMINIQUE RAIMBOURG : « PENSER LA PEINE AUTREMENT : PROPOSITIONS POUR METTRE FIN À LA SURPOPULATION CARCÉRALE » PUBLIÉ EN JANVIER 2013
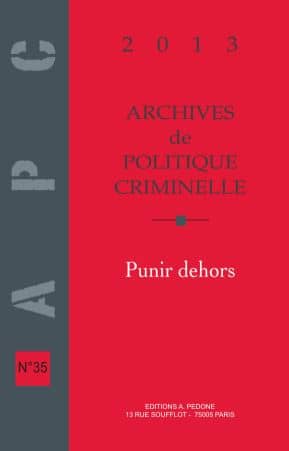 par ALAIN BLANC
par ALAIN BLANC
Ancien président de chambre à la cour d’appel de Douai
Président de l’Association Française de Criminologie
Extrait:
LES APPORTS ET LES LIMITES DU RAPPORT
« Les analyses et les préconisations du « rapport Raimbourg » sont importantes et indépendamment des remarques déjà formulées, constituent une plate-forme
solide de réformes de notre droit pénal et de notre procédure pénale.
Cela étant, ces propositions ne peuvent déboucher, du fait même des enjeux qu’elles comportent, sur des modifications de notre dispositif juridique sans être
rattachées à des orientations de fond : elles s’inscrivent parfaitement pour la plupart d’entre elles dans ce qui pourrait constituer ce dont notre pays a besoin
sur ces questions-là : un véritable new-deal pénal ou pour le dire autrement, un nouveau contrat social sur le pénal.
Examinons d’abord les limites des propositions du rapport qui sont de trois ordres :
1. Celles tenant à son objet même – la surpopulation carcérale – qui ne saurait suffire à asseoir des réformes de fond ou de procédure relevant d’enjeux plus complexes : aussi préoccupant que soit le problème, il ne peut être dissocié et encore moins résolu en faisant l’impasse sur la question de fond : celle de la qualité de la justice pénale. Il faut le dire
clairement et en tirer les conséquences, le recours à la prison, s’agissant de la très grande majorité des délits, est pour une bonne part la solution pauvre sur laquelle
se rabat une justice pauvre faute d’autres solutions plus efficaces à moyen et long terme, aggravant qui plus est la situation des publics les plus démunis.
C’est donc d’abord en identifiant tout ce qui devrait « enrichir » les dossiers, et en définissant les procédures et les modes de fonctionnement adaptés que l’on
réduira le recours à la prison : plusieurs préconisations du rapport vont dans ce sens, mais outre qu’elles sont souvent peu précises, elles ne sauraient emporter
l’adhésion que si elles sont référées à cet objectif de fond : plus de justice, plus d’efficacité par rapport à la prévention de la récidive.
Par exemple: « Favoriser les travaux de recherche criminologique » (proposition n°68) appelle des développements plus précis sur le fond, pour expliciter les
enjeux de cette préconisation : la criminologie aide à identifier les composantes du phénomène criminel pour trouver les réponses adaptées à moyen et long
terme à partir de la recherche des causes de la délinquance : chez le sujet, mais aussi dans son milieu de vie, et c’est bien là que doivent être trouvées les vraies
réponses pénales efficaces. Nous y reviendrons.
2. Autre limite, celle tenant à l’absence de prise en compte du contexte dans lequel ces réformes doivent intervenir :
à ce sujet il faut sans doute faire un peu d’histoire et réaliser à quel point nous sommes aujourd’hui dans une situation économique, morale, politique
particulière pour définir des stratégies opérationnelles. Nous sommes en 2013.
Ce qui est proposé – et les principes d’action proposés au même moment par le jury de conférence de consensus renforcent cette analyse : c’est à un renversement complet de tendance de la politique pénale conduite depuis plus de dix ans qu’il faut procéder. Il nous faut maintenant :
– rev
– penser la peine comme un contenu à adapter à chaque délinquant d’abord au moment de son prononcé, ensuite lors de sa mise en œuvre, en fonction de son évolution.
A cet égard, le débat sur le rapport Raimbourg qui a eu lieu le 19 mars 2013 à l’Assemblée Nationale atteste de la profondeur du blocage des politiques
concernant ces questions. Il faudra pourtant en sortir et par le haut avec un vrai débat public : il ne semble pas, par exemple, que l’on puisse aujourd’hui justifier le déplacement du contentieux de la délinquance routière vers des procédures administratives au seul motif de donner au juge correctionnel plus de temps pour d’autres contentieux : un travail plus approfondi sur l’analyse des effets des politiques conduites depuis une vingtaine d’années dans ce domaine – c’est une des rares politiques publiques conduite sans grande rupture entre les majorités politiques au pouvoir, et qui a fait l’objet de plusieurs évaluations – serait bienvenu.
De même, si la question du sens de la peine restera toujours « ouverte », elle est régie par le code pénal avec l’article 132-2413 : ce n’est pas parce que durant ces dix dernières années l’accent a été exclusivement porté sur l’effet dissuasif de la peine qu’il faut maintenant le négliger et remettre en cause les équilibres et la cohérence des incriminations du code pénal au seul regard d’impératifs de gestion.
Mme Annie Devos parle de vision stratégique ayant présidé à la réforme des structures judiciaires et pénitentiaires belges après l’affaire Dutroux. Nous n’en sommes pas encore là dans le débat public en France. »

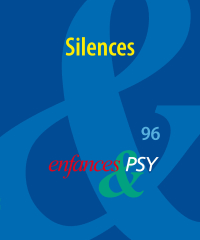

0 commentaire