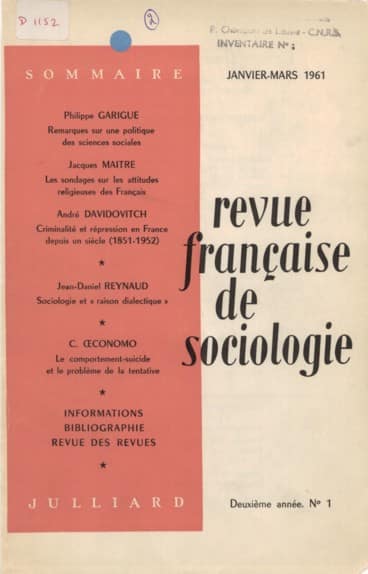
« L’examen de la personnalité »
Premier Congrès français de Criminologie
Lyon, 21-24 octobre 1960
Le premier congrès français de criminologie a porté témoignage d’un double renouveau : celui de la criminologie en France; celui de l’Ecole lyonnaise de criminologie. A ces deux titres, il était naturel de le placer sous le patronage spirituel d’Alexandre Lacassagne, pionnier de la première et fondateur de la seconde, dont l’œuvre a été évoquée à la séance inaugurale par les
professeurs Locard, Morel et Roche.
Placé sous la présidence du doyen Garraud, le congrès a consacré ses travaux à l’étude des problèmes posés par la mise en œuvre de V enquête sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale et sociale (prévue par l’article 81 du nouveau code de procédure pénale, en même temps qu’un examen médico-psychologique) .
Les rapports, qui ne sont pas encore tous publiés, et les discussions qui s’en sont suivies, intéressent le sociologue à plus d’un titre, et d’abord en tant qu’ils apportent, par-delà leurs préoccupations pratiques, un témoignage important sur le phénomène de la réception d’institutions nouvelles.
L’enquête de personnalité et l’examen médico-psychologique (distinct de l’expertise mentale qui subsiste, de l’article 64 du code pénal) constituent, en effet, un petit îlot révolutionnaire, bâti selon les vœux de la doctrine de défense sociale nouvelle, dans un cadre juridique où subsistent encore pas mal d’archaïsmes engendrés par le caractère répressif de l’ensemble de notre
droit pénal.
Des juristes, et notamment le professeur Levasseur, se sont demandés ce que ces dossiers devraient contenir (définition de la mission des experts par les juridictions d’information et de jugement) ; comment ils devraient être utilisés, compte tenu de l’état actuel de la procédure pénale (publicité des débats, droits de la défense, presse, etc.), par qui ils devraient être établis (services spécialisés de la police, enquêteurs sociaux professionnels, médecins criminologistes, psychologues, etc.).
Des magistrats, et plus particulièrement M. Reynaud substitut du procureur général près la Cour d’appel de Lyon, ont indiqué ce que ces dossiers contenaient, en l’état actuel de la pratique judiciaire. Ce rapporteur a insisté sur la modestie des ambitions du législateur en la matière, sur les difficultés de la mise en œuvre des infrastructures institutionnelles indispensables au bon fonctionnement de la réforme ; dans l’ensemble, sur l’attitude positive de la magistrature à l’égard des innovations qui ne représentent pas une rupture totale de traditions (rappel de l’ancienne enquête de curriculum vitae).
Les médecins ont souligné surtout les aspects humains des nouveaux examens de personnalité : le docteur Cotte a examiné les répercusisons des nouveaux textes sur le plan de la déontologie médicale. Les examens prévus doivent rester, c’est d’ailleurs l’exigence de la loi elle-même, des actes médicaux ; la libre adhésion du patient, est une condition indispensable de la réussite même du praticien, dont la mission ne devra entraîner aucun manquement aux obligations de secret professionnel. Le médecin, dans l’hypothèse de l’examen médico-psychologique, n’est pas un rouage de l’appareil probatoire de la justice; il apporte des éléments utiles au choix de la mesure de traitement la mieux adaptée à la personnalité du délinquant.
Le professeur agrégé Colin a pour sa part évoqué les Perspectives cliniques de l’examen de personnalité par rapport à l’expertise psychiatrique classique. L’univers clinique est celui du singulier, dit-il. La démarche médicale est thérapeutique. La criminologie clinique est fondée sur le dialogue entre le clinicien et le délinquant. Elle se distingue de la criminalistique qui est du domaine des choses, tandis que la criminologie est du domaine de l’homme. L’engagement thérapeutique est la seule justification de l’approche
clinique. Par conséquent, les comptes rendus cliniques ne sont pas utilisables comme preuve du délit. Ici, le docteur Colin rejoint le docteur Cotte, tout en insistant sur la nécessaire réhabilitation du domaine médical public en tant qu’univers de valeurs. Cela aboutit à la conciliation des devoirs du médecin envers le malade qui souffre (tout délinquant est un malade social) et de la société.
Divers autres rapports (Dagognet : Sanction et thérapeutique). (Delamour et Susini : Contribution de la police à l’enquête de personnalité ; Mme Buffard : Le rôle des tests psychologiques dans l’examen de personnalité ; M »ie Weil : Utilisation des dossiers de personnalité par V administration pénitentiaire; Stancius : Perspectives ouvertes par la procédure pénale, etc.), mériteraient mieux qu’une simple mention.
Parmi les interventions on doit noter celles de M. Jean Pinatel au nom de la Société internationale de Criminologie, du professeur di Tullio au nom de l’Université de Rome, du professeur agrégé Ley directeur des services psychiatriques de l’administration pénitentiaire belge, de M. le Conseiller Marc Ancel dans sa réplique au professeur Lacroix (M. Lacroix n’a pas hésité à voir dans la justice une certaine rationalisation de la vengeance), et aussi celle de l’écrivain Georges Simenon.
La publication des actes du congrès, clôturé par une journée d’études sur l’alcoolisme et la criminalité (Rapport introductif établi par le professeur Heuyer), nous fournira sans doute l’occasion de présenter un exposé plus complet des importants problèmes qui y furent évoqués et, dans une certaine mesure, résolus, au moins sur le plan des principes.
A. Davidovitch.