Une orientation de fond : pour une criminologie d’émancipation
(Extrait du rapport moral à l’AG d’avril 2015)
 De quelle criminologie voulons-nous ?
De quelle criminologie voulons-nous ?
Dès 2008 nous avions posé ce concept pour l’opposer à une criminologie de contrôle social ou sécuritaire.
Promouvoir une criminologie d’émancipation c’est d’abord être plus exigeant sur la pluridisciplinarité : seule l’approche d’un crime ou d’un phénomène criminel à travers toutes les disciplines constitutives de la criminologie permet de l’appréhender dans ses différents aspects et causalités et donc d’avoir une chance d’y trouver de bonnes réponses.
Cette criminologie doit à notre sens se décliner sur trois domaines : le sujet délinquant, la victime, et les institutions.
Emancipation du délinquant :

des politiques publiques de prévention de la délinquance et de lutte contre la récidive qui puissent être efficaces. La conférence de consensus a constitué à ce sujet un
socle essentiel.
Ensuite affirmons que s’il est nécessaire et légitime de repérer les risques de récidive, il est aussi indispensable pour des raisons de droit, de justice mais aussi
d’efficacité, de repérer les besoins des justiciables.
En somme, et ce n’est pas le plus simple, il faut changer de paradigme : au lieu de mettre la dangerosité au centre, il faut y substituer, y remettre l’éducation. Mais avec tout ce que cela implique, à savoir la volonté légitime, assumée, de changer la personne, de préparer, d’activer sa sortie de délinquance.
Et, puis comme l’a fait la loi du 15 août 2014 pour laquelle nous nous sommes beaucoup investis à l’AFC, cessons de considérer que c’est la personnalité qu’il faut évaluer, alors que c’est tout autant le contexte dans lequel les faits ont été commis qui permettent d’en appréhender les tenants et les aboutissants, et de définir des méthodes de prises en charge, des politiques, des programmes, de nature à générer la sortie de délinquance.
Il faut le dire clairement, évaluer les risques de récidive d’un délinquant n’est pas en soi stigmatisant ou attentatoire aux libertés. On peut même affirmer que se dispenser de le faire revient non seulement à négliger les risques pour l’ordre public, mais aussi ceux encourus par le sujet lui-même avec qui cette évaluation doit être partagée.
L’émancipation peut passer par la répression, c’est même nécessaire pour un délinquant.
Mais tout est question de méthodes d’éthique et de philosophie. En dehors des méthodes contestables sur le plan simplement technique – il y en a – certaines
le sont éthiquement ou déontologiquement parce qu’elles ne respectent pas le sujet ou sont mises en œuvre sans qu’il y soit associé.
Sans aborder le débat au fond sur les outils d’évaluation des personnes relevant de la justice pénale et sur les méthodes à mettre en œuvre – débat sur lequel il va nous falloir prendre des initiatives dans l’année qui vient – nous restons convaincus que trois principes doivent être absolument respectés :
- La pluridisciplinarité des évaluations à quelque stade du processus pénal qu’elle se fasse doit être garantie;
- L’évaluation doit porter comme la loi du 15 août 2014 le stipule, non seulement sur la personnalité du sujet mais sur le contexte familial économique et social des faits commis ;
- Le recours aux outils actuariels ne doit pas être substitué aux outils cliniques, les deux s’avérant complémentaires.
- Le sujet doit être associé à cette évaluation, à son sens, à sa portée ;
Pour nous, recourir à une criminologie émancipatrice vis-à-vis d’un délinquant c’est choisir un positionnement philosophique, éthique, et institutionnel fondé sur le respect de sa personne, de ses droits, – qui sont aussi à promouvoir – et définir avec lui une stratégie d’intervention qui vise à l’accompagner dans le processus de modification de son rapport à la loi.
A cet égard les mesures de sûreté qui relèvent d’un droit d’exception par rapport aux grands principes de notre droit pénal, constituent actuellement un foyer de développement de cette criminologie de contrôle et de stigmatisation caractérisée par une philosophie mais aussi par des outils et des méthodes qui sont à l’opposé de la criminologie d’émancipation que nous entendons promouvoir à l’AFC : aucune évaluation véritablement pluridisciplinaire n’y est assurée, les psychiatres – dont certains ont des options affichées sur ces questions – sont seuls mobilisés en tant qu’évaluateurs et les CPIP sont focalisés dans le cadre du mandat du Jap sur le contrôle des obligations : dans ce cas de figure, la criminologie – mais aussi la psychiatrie – est dévoyée et ne sert que d’alibi « scientifique » à un pur et simple contrôle social.
Emancipation de la victime :
La victimologie a toujours fait partie de la criminologie. Assez logiquement d’ailleurs au vu des politiques conduites pendant de longues années, on peut remarquer que depuis quelques années l’attention portée aux victimes et à la victimologie a meilleure « presse » que la criminologie.
S’agissant de l’émancipation de la victime d’infractions pénales, la question essentielle est celle des méthodes à mettre en œuvre pour que la victime puisse à la fois rentrer dans ses droits, mais aussi « s’émanciper » le plus tôt possible de son « statut » de victime.
Il y a là tout un domaine de réflexion à partir des différentes réponses apportées selon les pays, selon la structuration des institutions et les systèmes juridiques sur la question principale : la prise en charge ou la « réparation » de la victime elle-même doit-t-elle être conçue en maintenant un lien étroit avec la Justice et la cause du préjudice comme en Belgique mais aussi dans le cadre des pratiques de Justice restaurative ( émancipatrice du condamné et de la victime ) dont Robert Cario est le spécialiste, ou au contraire « décrochée » de la Justice comme le préconise par exemple Geneviève Giudicelli Delage ?
Toujours-est-il que la victimologie ne saurait être détachée de la criminologie : nous posons l’hypothèse que les stratégies tendant à l’émancipation du délinquant sont étroitement liées à celles qui en parallèle visent à émanciper la victime : elles reposent sur le même socle philosophique, et produisent des effets en miroir soit positifs, soit régressifs : l’idéologie de l’Institut pour la Justice illustre très bien ce phénomène des victimes renforcées dans leur statut, et souvent exploitées à des fins explicites et en l’espèce revendiquées « d’élimination » des délinquants.
Penser les institutions de telle sorte qu’elles soient émancipatrices :
Celles de la Justice évidement : juridictions, services pénitentiaires, mais aussi en amont et en aval de toutes celles participant à la définition du vivre ensemble sur
un territoire donné. C’est là aussi le pari selon lequel les institutions changent les gens et peuvent le faire positivement : une audition de police, une audience de
tribunal, un accueil en maison d’arrêt, une consultation par un psychologue ou un psychiatre, selon la manière dont ils sont assurés, peuvent générer du changement
ou au contraire du blocage ou de la régression.
Mais la délinquance est aussi le reflet de la société dans laquelle elle se produit. La société doit être en mesure de se confronter à la délinquance qu’elle
secrète, en analyser les causes, et en tirer des conséquences. La criminologie aide aussi à cela et toutes les institutions, tous les métiers ayant à prévenir, gérer,
répondre à, ou commenter la délinquance devraient y avoir recours : métiers ayant recours au travail social, journalistes, élus etc….
AB
27 mai 2015
Addendum : Il va de soi que ce concept de criminologie d’émancipation – par opposition à une criminologie de contrôle social ou sécuritaire – implique une clarification du concept d’émancipation lui-même, en faisant appel à ce que la philosophie, l’anthropologie et les sciences humaines en général peuvent apporter à ce sujet. Mais il comporte sans doute un « impensé » ou un implicite qu’il faut formuler ici et qui renvoie à une question philosophique sur la peine, et donc sur le pénal. Nous posons en effet le principe que la peine peut être émancipatrice sans doute en référence plus ou moins consciente à Paul Ricoeur. Et que la criminologie que nous défendons aide à y parvenir. Ce préalable mérite sans doute d’être discuté.
13 septembre 2015
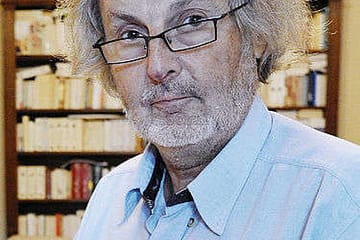


0 commentaire