Quelles leçons tirer de la période écoulée entre fin 2017 avec l’émergence, dans le tumulte, du mouvement Me Too, et la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille ?
« Il faut éviter le retour au paradigme flou et pernicieux de la dangerosité, avec les risques d’essentialisation des auteurs qu’il comporte »
 Elles sont de plusieurs ordres. On peut en premier lieu affirmer que les mouvements sociaux ou militants sont nécessaires pour permettre une prise de conscience d’injustices ou de dysfonctionnements des institutions. Cependant, de tels mouvements ne peuvent être qu’une étape compte-tenu des excès dont ils sont inévitablement porteurs ; on l’a vu avec les slogans et les appels à la répression la plus archaïque, au mépris de l’État de droit. En l’espèce, la société est revenue à la raison et la reprise par les politiques a permis que les compromis indispensables débouchent sur une loi équilibrée, ce qui est déjà beaucoup mieux que les lois votées dans la foulée de différents faits divers ces dernières années. Parallèlement, les juridictions ont pris des initiatives dont on ne peut a priori que se féliciter : des dispositifs de justice résolutive de problèmes se sont mis en place pour adapter leur fonctionnement à une gestion dynamique des étapes du parcours de l’auteur et de la victime et trouver des réponses plus efficaces à chaque situation. L’efficacité, au centre
Elles sont de plusieurs ordres. On peut en premier lieu affirmer que les mouvements sociaux ou militants sont nécessaires pour permettre une prise de conscience d’injustices ou de dysfonctionnements des institutions. Cependant, de tels mouvements ne peuvent être qu’une étape compte-tenu des excès dont ils sont inévitablement porteurs ; on l’a vu avec les slogans et les appels à la répression la plus archaïque, au mépris de l’État de droit. En l’espèce, la société est revenue à la raison et la reprise par les politiques a permis que les compromis indispensables débouchent sur une loi équilibrée, ce qui est déjà beaucoup mieux que les lois votées dans la foulée de différents faits divers ces dernières années. Parallèlement, les juridictions ont pris des initiatives dont on ne peut a priori que se féliciter : des dispositifs de justice résolutive de problèmes se sont mis en place pour adapter leur fonctionnement à une gestion dynamique des étapes du parcours de l’auteur et de la victime et trouver des réponses plus efficaces à chaque situation. L’efficacité, au centre
des préconisations de la conférence de consensus sur la récidive de 2003, porterait-elle ses fruits ?
Mais il y a des conditions à la réussite de ces avancées : les moyens humains bien sûr, y compris en formation. Ensuite, la pluridisciplinarité des évaluations et un suivi faisant appel aux savoirs criminologiques pour analyser les causes des violences et les travailler. Enfin, il faut éviter le retour au paradigme flou et pernicieux de la dangerosité, avec les risques d’essentialisation des auteurs qu’il comporte : on se souvient en effet que le concept de dangerosité criminologique – pour faire la différence avec la dangerosité psychiatrique – avait été posé par le rapport Santé-Justice Burgelin de juillet 2005, remis à la suite d’une saisine du Président de la République de l’époque pour réagir à l’émotion créée par plusieurs crimes sexuels. Le concept n’a pas plus été défini depuis, mais il a constitué le socle de la loi du 25 février 2008 créant la rétention de sûreté, la « peine sans crime », dont il serait sans doute intéressant de savoir ce qu’il en a été fait dans la pratique (à notre connaissance, la seule structure créée à Fresnes à partir de cette loi est aujourd’hui vide).
Le risque existe toujours de négliger, dans les évaluations de dangerosité, le contexte social et les facteurs exogènes des faits de violences pour ne retenir, dans le cadre d’une procédure accélérée, que les critères psychologiques ou psychiatriques (rappelons que « dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux
finalités de la peine énoncées à l’article 130-1 » ; C. pén., art. 132-1). Les dispositifs qui se mettent en place devront donc être suivis avec intérêt et vigilance.

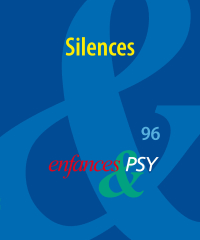

0 commentaire