Evaluation du risque et dangerosité criminologique
 ⚖️ Va-t-il récidiver, monsieur l’expert ? L’une des questions récurrentes dans les procès de crimes violents est celle de la dangerosité de l’auteur.
⚖️ Va-t-il récidiver, monsieur l’expert ? L’une des questions récurrentes dans les procès de crimes violents est celle de la dangerosité de l’auteur.
La Haute Autorité de Santé rappelle que la notion dangerosité s’est développée avec l’apparition en France de la figure du récidiviste (Garofalo, 1885) et qui réapparu dans les discours des 80’s suivant le courant punitif émergeant aux USA suite au rapport Martinson de 1974, « Nothing Works ».
Historiquement, 2 types de dangerosités sont distingués.
👉 La dangerosité psychiatrique correspondant au risque de violence de sujets présentant des troubles mentaux. La symptomatologie du registre schizophrénique paranoïde (ou l’héboïdophrénie) y est le plus souvent associé. Celle-ci pouvait diminuer en fonction de l’efficacité du traitement pharmacologique administré.
👉 La dangerosité criminologique désignant l’évaluation d’un risque de récidive d’un sujet ayant commis un passage à l’acte, mais non liée à des injonctions délirantes. Il s’agit d’une évaluation probabiliste d’un risque d’un autre passage à l’acte du sujet qui, le plus souvent, présente des troubles de personnalité sans relever d’une maladie mentale. On regarde ici du côté du mode de vie et la nature des relations interpersonnelles pouvant favoriser des conduites transgressives.
Progressivement, le terme « dangerosité » qui induisait un état dangereux, fixe et durable, a fait place au concept d’évaluation du risque.
〽️ La dimension probabiliste du risque sied mieux à l’évaluation des conduites criminelles. C’est bien l’intrication entre plusieurs facteurs qui vont favoriser la survenue d’un passage à l’acte.
Aujourd’hui, des modèles fondés sur ces approches criminologiques existent, dont le modèle Risque Besoin Réceptivité, afin d’évaluer le niveau de risque de réitération, les besoins criminogènes et la réceptivité du sujet au traitement proposé.
🔎 L’expert ne se contente de saisir des données en lisant un score obtenu à partir d’un outil : il analyse en s’appuyant sur le parcours de vie du sujet et l’infraction commise.
Si l’entretien avec le sujet est central, il est couplé à une connaissance du dossier pénal, à l’utilisation de questionnaires de personnalité et d’échelles d’évaluation (HCR 20, Static 99 R, Stable 2007, VRAG-R…) qui permettent une appréhension plus fine du risque criminologique. C’est ce qui constitue le Jugement Professionnel Structuré.
🔏Les outils d’évaluation fondés sur les résultats de recherches criminologiques délivrent donc le sujet d’un « état ».
⚙️Surtout, l’identification de facteurs de risques criminologiques fournira des axes de travail thérapeutique (addiction, antécédents, sexualité dysfonctionnelle…) sur lesquels pourront être concentrés tous les efforts.
🎯 Encore une exemple de l’intérêt de défendre une approche
criminologique basée sur les résultats de la recherche, non ?
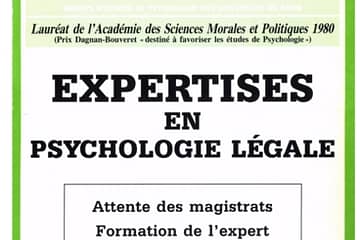
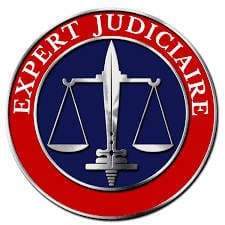

0 commentaire